|

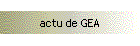
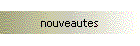
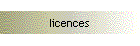
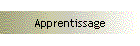
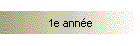
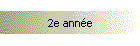
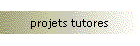
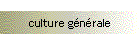
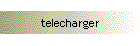
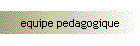
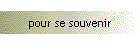
| |
|
Axes problématiques
Essais de définitions |
|
|
|
Politique
Pourquoi distinguer entre le
et la politique? Distinguo moderne mais qui a son sens.
On en trouvera une approche
ici
Dans politique, il y a deux aspects, nettement distincts
qui débouchent sur deux approches, deux problématiques, deux champs
théoriques.
 |
l'action politique. C'est
le champ de la politique. Au delà même du jugement hâtif et
péjoratif que l'on peut toujours hasarder sur la médiocrité des faits et
gestes quotidiens de nos hommes politiques, elle représente un continent
à soi seul qui est celui à la fois de l'actualité et de l'histoire. Dans
ce champ là il y a à observer - et essayer de comprendre - les
présupposés idéologiques, théoriques de ce qui s'est fait ou dit.
Et tenter de repérer surtout ce qui y relève de la pure contingence, du
pragmatisme voire de l'opportunisme (et l'on sait aussi combien la
politique sait être l'art de saisir les occasions, et, donc, celui de
ré-agir plus que d'agir) et ce qui relève d'une volonté déterminée
assise sur une pensée politique précise.
On sait notamment combien un De Gaulle,
quoiqu'il en eût, se méfiait des idéologies et s'affirmait plutôt comme
un pragmatique que comme un idéologue, alors même que toute sa pratique
se révéla être sous-tendue par une volonté trempée. A l'inverse, tout
habité qu'il fut d'une pensée politique assise, Clemenceau semble plus,
dans sa pratique politique, comme un acteur réagissant aux circonstances
que comme ce radical qu'il prétendait être. |
 |
la pensée politique qui la sous-tend ou, en
tout cas, est supposée la sous-tendre.
Ce que nous cherchons à comprendre c'est le fondement des théories
politiques.
Quels sont les concepts centraux? Quelles sont les problématiques?
Quelle est la conception du monde, de l'homme qui justifie telle ou
telle conception, puis telle ou telle action. |
C'est cette dernière qui vous intéresse et non pas
le fil incessant des polémiques et des affaires vécues au jour le jour.
Rappelons la formule de
Bachelard pour qui si le scientifique prend les faits pour des idées
c'est-à-dire des données qui doivent être vérifiées, analysées,
critiquées, en revanche l'épistémologue doit
prendre les idées pour des faits
Ce qui signifie que ce sont des territoires à investir,
comme s'il s'agissait de l'objet d'une science dure. Et appliquer la
même démarche expérimentale (observation, analyse, hypothèse, déduction,
vérification) que si l'on trouvait devant un objet physique ou
biologique, par exemple.
voir Définition dans le
TLF
De là
une série de questions et des concepts à repérer et interroger
 |
La politique est-elle un art (une technique) ou bien
est-elle aussi une théorie?
Il n'y a pas de pratique qui ne s'appuie sur une théorie, explicitement
ou implicitement. Toute la question est de savoir si cette théorie est
extérieure à la politique ou interne. Si elle lui est extérieure de quoi
s'agit-il? De
 |
morale |
 |
métaphysique |
 |
philosophie |
 |
religion |
|
 |
n'est-ce pas la caractéristique et/ou la duperie en
tout cas le
mythe, du pragmatisme voire du
libéralisme que de nous faire accroire qu'il y eût seulement une
pratique dont le seul objet serait de s'adapter continûment aux flux
contradictoires et désordonnés des événements. |
Quelques hypothèses pour quelques concepts
 |
Le politique est affaire de la cité. Cette affaire
est-elle commune ou non? d'où res publica
|
 |
Quel est le fondement, la justification, l'objet de la
cité? La perçoit-on comme une nécessité
toute droite issue de la nature sociale de
l'homme, ou comme le résultat d'un engagement, d'un choix et donc
comme un fait historique, un événement issu de la
volonté libre quoique déterminée? il faut donc interroger le sens
accordé dans chaque aire théorique à la liberté.
|
 |
Quel rapport entre le tout et la partie? L'individu
existe-t-il par lui-même, ou bien n'est-il que par la relation qu'il
entretient avec le tout, la cité? Il faut donc interroger la notion même
d'individu |
 |
N'est-ce pas le but du politique que d'installer un
mode de fonctionnement de la cité qui n'entrave le développement ni de
l'un ni de l'autre? Autant dire qu'alors logiquement il n'y aurait que
trois flexions logiques possible de ces rapports
 |
la cité prend le pas exclusif sur le développement de
l'individu |
 |
l'individu prend le pas exclusif sur le développement
de la cité |
 |
il y a une voie moyenne qui permette à l'un de se
développer sans entraver l'autre. |
Les différents champs théoriques se distribuent
effectivement selon ces trois dispositions alternatives. Ce que j'ai
essayé de
signaler. |
 |
Comment est organisée la cité? Quelle est l'unité de
base? l'individu? la famille? la tribu etc.? autant de concepts à
interroger |
 |
cet unité de base, cet atome, est-il perçu comme un
obstacle au tout, qu'il faudrait donc contraindre, juguler c'est-à-dire
ordonner; ou bien au contraire est-il perçu comme le fondement du tout
c'est-à-dire comme ce qu'il faut préserver et asseoir dans son
intégrité? Bref, est-il un obstacle ou un moyen? |
 |
toute société est un système d'ordre. Quel rapport ce
système entretient-il avec la liberté? N'est-elle pensable qu'au stade
du tout ou bien est-elle compatible avec celle de la partie? En cas de
crise, quel est le paramètre à préserver? l'ordre ou la liberté? |
 |
Qui dit ordre, dit loi. Quelle est sa place et,
notamment, comment ordonne-t-elle la vie du citoyen. Où commence et
s'arrête son domaine de compétence? |
 |
L'État: ce n'est ni une évidence ni une universalité.
|
 |
La nation: à interroger elle -aussi et donc
l'Etat-Nation
|
|
|
![]()