|

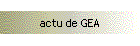
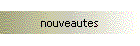
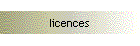
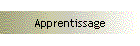
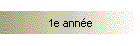
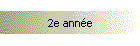
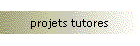
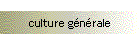
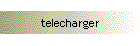
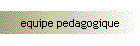
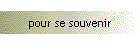
| |
| Individu /société
|
|
Etymologie
|
|
Ne jamais
oublier que l'individu, c'est d'abord ce qui est indivisible. L'élément
premier. Il est donc, en latin, ce qu'en grec on nomme atome: a-tomos
ce qui ne se découpe pas. Si une société doit s'entendre comme composée
d'éléments premiers (individu pour les uns, famille pour les autres) alors
il faut comprendre qu'elle se présenterait comme une grandeur discontinue,
non pas comme un espace ou un temps (qui eux sont divisibles à l'infini)
mais comme une entité rationnelle, arithmétique en quelque sorte,
c'est-à-dire comme une façon de penser le réel.
|
L'acte de naissance de la société
|
|
Y en a-t-il seulement un? Peut-on comme Rousseau se dire
qu'au départ, il y aurait un état pré-social, un état de nature et qu'ainsi
l'homme serait entré en société par un acte volontaire, historique,
repérable et analysable?
Évidemment non!
 |
d'abord parce que si l'homme est chronologiquement
premier, logiquement c'est la société qui est première et l'homme second. L'homme est un
animal politique. Puisqu'il n'est homme que sous le regard de l'autre,
des autres hommes, qu'il ne prend conscience et construit son humanité
que dans la relation avec un autre homme. La condition de possibilité de
l'homme est, bien entendu le fait social lui-même, la co-présence au
monde et le sentiment qu'on en a. |
 |
ensuite, parce que même si par absurde, une telle
hypothèse devait se vérifier, nul ne serait là, ni trace ni témoignage
pour l'attester. Qu'une hypothèse invérifiable et non explicative en
toute logique est une absurdité. |
 |
enfin parce que Rousseau lui-même ne l'a jamais avancé.
Ce dernier, cohérent, avance en réalité quelque chose comme une
hypothèse d'école, un raisonnement a contrario. Pour comprendre ce
qu'est une société, son fondement, imaginons ce qui se serait passé si
elle n'existait pas. Tel est le sens de l'état de nature. |
|
Se poser la question en terme de fondement pas
d'histoire
|
|
voir
Bossuet |
Si les formes que prennent les sociétés se comprennent en
raison des circonstances et déterminismes historiques (économiques,
politiques, sociaux, idéologiques ...) en revanche le fait social lui
s'entend en terme de fondement, c'est-à-dire ce que qui le fonde, à la
racine: l'essence de l'homme.
Ce qui alors apparaît assez clairement: les théories
politiques dépendent dans une large mesure de la conception positive ou
négative qu'elles se sont de l'homme. Le fondement du politique est
donc bien aussi idéologique. Il est en tout cas
philosophique. |
Au centre, la question de la violence
|
| Rousseau
Hobbes
Girard |
Elle fonde la justification du fait social aux yeux de
presque tous les auteurs. Une violence interminable, sans cesse reproduite
parce que justement la coalition même des faibles peut vaincre les forts
et n'évite pas même la riposte ultérieure. Non parce qu'elle serait
répréhensible moralement, mais qu'elle remette en cause la reproduction
même de l'espèce, la violence est cela même que la société doit
pourfendre. Que paradoxalement elle reproduit en pourfendant même. |
A la périphérie la question du travail
|
| Freud
Hyppolite
Bataille
|
Que ce soit du point de vue de la phénoménologie, ou de
la psychanalyse, le travail apparaît comme un des moyens de canaliser ou
sublimer cette violence tout en garantissant la pérennité de la conscience
humaine.
Toute la question, et elle est politique, reste alors de
savoir si toute société est nécessairement répressive et doit le rester
(Freud), ou si, au, contraire, elle peut être au service sinon des désirs
tout au moins de la liberté des individus.
On observera donc attentivement comment, de
périphérique, la question du travail, deviendra centrale, et comment
toutes les problématiques politiques s'en trouvent modifiées. |
|
![]()