|

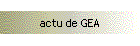
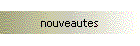
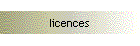
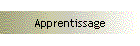
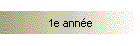
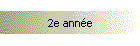
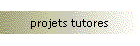
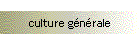
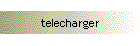
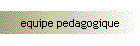
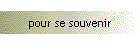
| |
|
3 extraits
|
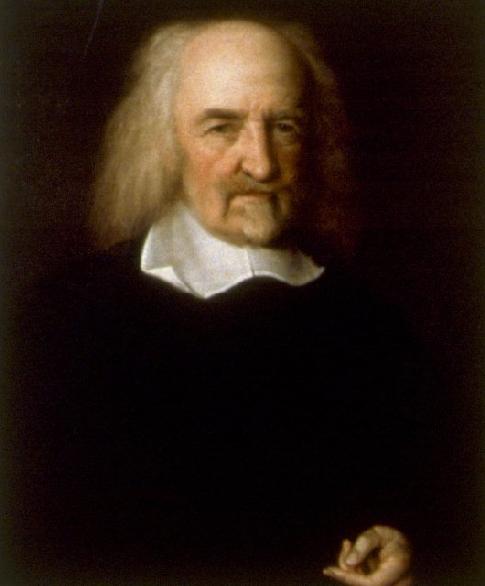
Hobbes
|
|
|
“Nous pouvons trouver dans la nature humaine trois causes
principales de querelles : premièrement, la rivalité; deuxièmement, la
méfiance; troisièmement, la fierté.
La première de ces choses fait prendre l'offensive aux hommes en vue de
leur profit. La seconde, en vue de leur sécurité. La troisième en vue de
leur réputation. Dans le premier cas, ils usent de la violence pour se
rendre maîtres de la personne d'autres hommes, de leurs femmes, de leurs
enfants, de leurs biens. Dans le second cas, pour défendre ces choses.
Dans le troisième cas, pour des bagatelles, par exemple pour un mot, un
sourire, une opinion qui diffère de la leur, ou quelque autre signe de
mésestime, que celle-ci porte directement sur eux-mêmes, ou qu'elle
rejaillisse sur eux, étant adressée à leur parenté, à leurs amis, à leur
nation, à leur profession, à leur nom.
Il apparaît clairement par là qu'aussi longtemps que les hommes vivent
sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette
condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre
chacun.” |
Rapport à l'autre
Lévinas
Lipovetsky
Bergson
Risque
de la violence
Hobbes
Memmi
Rousseau
Girard
Canaliser la violence
Rousseau
Girard
Freud
Bataille
Etat fort
Hobbes
Lefort
Arendt
|
| |
Se donner à l'Etat
La seule façon d'ériger un tel pouvoir commun, apte à
défendre les gens de l'attaque des étrangers, et des torts qu'ils
pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les protéger de telle
sorte que par leur industrie et par les productions de la terre, ils
puissent se nourrir et vivre satisfaits, c'est de confier tout leur
pouvoir et toute leur force à un seul homme, ou à une seule assemblée, qui
puisse réduire toutes leurs volontés, par la règle de la majorité, en une
seule volonté. (...) Cela va plus loin que le consensus ou la concorde: il
s'agit d'une unité réelle de tous en une seule et même personne, unité
réalisée par une convention de chacun avec chacun passée de telle sorte
que c'est comme si chacun disait à chacun; j'autorise cet homme ou cette
assemblée, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette
condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses
actions de la même manière. Cela fait, la multitude, ainsi unie en une
seule personne est appelée une République, en latin CIVITAS.
|
|
| |
Et parce que l’état de l’homme, comme il
a été exposé dans le précédent chapitre, est un état de guerre de chacun
contre chacun, situation où chacun est gouverné par ses propres motifs et
qu’il n’existe rien, dans ce dont on a le pouvoir d’user, qui ne puisse
éventuellement vous aider à défendre votre vie contre vos ennemis, il
s’ensuit que, dans cet état, tous les hommes ont un droit sur toutes
choses, et même les uns sur le corps des autres. C’est pourquoi aussi
longtemps que dure ce droit naturel de tout homme sur toute chose, nul,
aussi fort ou sage fût-il, ne peut être assuré de parvenir au terme du
temps de vie que la nature accorde ordinairement aux hommes.
En conséquence c’est un précepte, une règle générale de la raison, que
tout homme doit s’efforcer à la paix aussi longtemps qu’il a un espoir de
l’obtenir; et quand il ne peut pas l’obtenir, qu’il lui est loisible de
rechercher et d’utiliser tous les secours et tous les avantages de la
guerre. La première partie de cette règle contient la première et
fondamentale loi de nature qui est de chercher et de poursuivre la paix.
La seconde récapitule l’ensemble du droit de nature, qui est le droit de
se défendre par tous les moyens dont on dispose.
De cette fondamentale loi de nature par laquelle il est ordonné aux hommes
de s’efforcer à la paix, dérive la seconde loi: que l’on consente, quand
les autres y consentent aussi, à se dessaisir, dans toute la mesure où
l’on pensera que cela est nécessaire à la paix et à sa propre défense, du
droit qu’on a sur toute chose; et qu’on se contente d’autant de liberté à
l’égard des autres qu’on en concéderait aux autres à l’égard de soi-même.
Car aussi longtemps que chacun conserve ce droit de faire tout ce qui lui
plaît, tous les hommes sont dans l’état de guerre. Mais si les autres
hommes ne veulent pas se dessaisir de leur droit aussi bien que lui-même,
nul homme n’a de raison de se dépouiller du sien, car ce serait là
s’exposer à la violence (ce à quoi nul n’est tenu) plutôt que se disposer
à la paix. Cette loi est celle de l’Évangile qui dit: tout ce que tu
réclames que les autres te fassent, fais-le leur ainsi que la loi commune
à tous les hommes qui dit: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.
Se dessaisir de son droit sur une chose, c’est se dépouiller de la liberté
d’empêcher autrui de profiter de son propre droit sur la même chose […]
On se démet d’un droit, soit en y renonçant purement et simplement, soit
en le transmettant à un autre. En y renonçant purement et simplement quand
on ne se soucie pas de savoir à qui échoit le bénéfice d’un tel geste. En
le transmettant, quand on destine le bénéfice de son acte à une ou
plusieurs personnes déterminées. Et quand un homme a, de l’une ou l’autre
manière, abandonné ou accordé à autrui son droit, on dit alors qu’il est
obligé ou tenu de ne pas empêcher de bénéficier de ce droit ceux auxquels
il l’a accordé ou abandonné; qu’il doit, car tel est son devoir, ne pas
rendre nul l’acte volontaire qu’il a ainsi posé; et qu’un tel acte
d’empêchement est une injustice ou un tort, étant accompli sine jure. La
transmission mutuelle de droit est ce qu’on nomme contrat. |
|
|
![]()